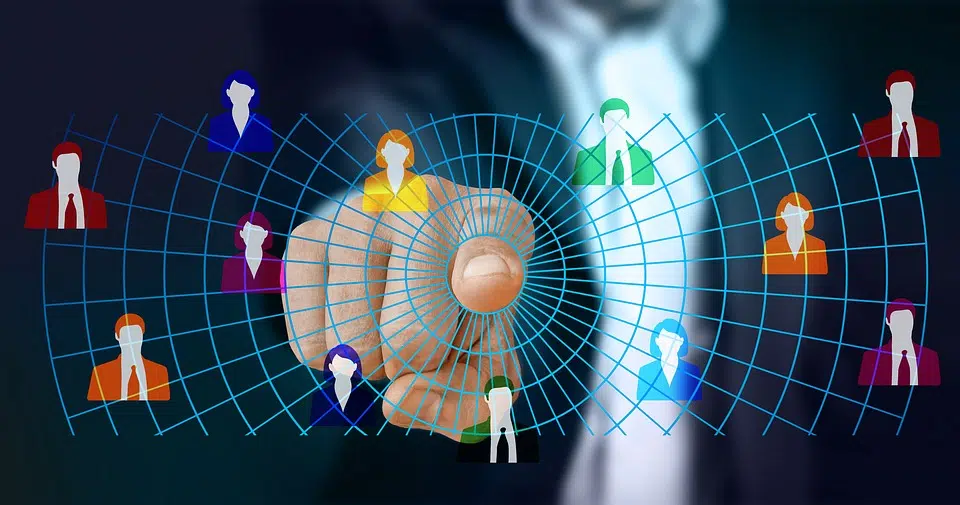En France, un foyer dont le patrimoine dépasse 1,3 million d’euros est soumis à l’impôt sur la fortune immobilière, tandis que les revenus issus du capital bénéficient d’un taux forfaitaire de 30 %, bien inférieur à la tranche marginale de l’impôt sur le revenu. En 2022, les 370 foyers les plus riches ont versé en moyenne un taux effectif d’imposition inférieur à celui de nombreux cadres moyens.
Depuis 2023, plusieurs propositions de loi visent à instaurer une taxe « exceptionnelle » sur les ultra-riches, alimentant le débat sur l’efficacité et l’équité de la fiscalité française. Les écarts de contributions restent importants, malgré les mécanismes existants.
Qui sont les milliardaires en France et comment leur fortune est-elle imposée ?
En France, la sphère des milliardaires ne compte qu’une poignée d’acteurs, mais leur influence sur l’économie nationale est considérable. Bernard Arnault, François Pinault, la famille Bettencourt Meyers… Ces familles incarnent la puissance financière et la concentration des plus hauts patrimoines, bâtis sur des décennies de succès industriels, de conquêtes dans le luxe ou de manœuvres dans les médias. Leur fortune s’articule autour d’actions, de sociétés, de biens immobiliers, bien plus que de liquidités directement soumises à la fiscalité ordinaire.
D’après les analyses de l’IPP compilées par les économistes Gabriel Zucman et Laurent Bach, plus la richesse grimpe, plus le taux d’imposition effectif décroît. Pour les 370 foyers les plus fortunés, la part des impôts versée ne dépasse pas 26 % de leurs revenus, un niveau inférieur à celui imposé à de nombreux cadres supérieurs. Cette situation s’explique par une architecture fiscale peu symétrique : l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ne vise que les actifs immobiliers excédant 1,3 million d’euros, et laisse hors de portée la majorité des placements financiers.
Pour y voir plus clair, voici comment les principaux pans de la fortune des milliardaires sont traités par l’impôt :
- Le patrimoine immobilier : l’IFI s’applique, avec un taux progressif pouvant atteindre 1,5 %.
- Les revenus du capital : soumis à la flat tax de 30 %, souvent réduite grâce à des dispositifs d’optimisation.
- Rémunérations et dividendes : fréquemment optimisés via des sociétés holdings, limitant leur exposition à l’impôt sur le revenu classique.
Le ministère de l’Économie lui-même admet que les plus-values latentes, c’est-à-dire les gains non encore concrétisés, échappent largement à l’imposition tant qu’aucune vente n’a lieu. Au final, les impôts acquittés par les milliardaires apparaissent souvent en décalage avec la valorisation réelle de leur fortune, ce qui ne manque pas d’attiser la polémique sur la justice fiscale et la pertinence des dispositifs existants.
Panorama des principaux impôts acquittés par les plus riches
La fiscalité qui s’applique aux milliardaires ressemble à un labyrinthe qui privilégie certains profils. Dans la plupart des cas, les plus riches échappent à l’impôt progressif sur le revenu, car leur richesse provient majoritairement de la détention d’actions ou de parts dans des sociétés. Le barème de l’impôt sur le revenu atteint bien 45 % pour la tranche la plus élevée, mais cette réalité ne concerne qu’une minorité d’ultra-riches. Ils privilégient les revenus du capital, fiscalisés à la flat tax de 30 %, un taux bien plus léger que celui subi par les cadres ou professions libérales.
Le patrimoine immobilier, dès lors qu’il franchit le seuil de 1,3 million d’euros, tombe sous le coup de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Mais la structure des grandes fortunes fait la part belle aux actifs financiers, bien moins exposés à cette taxe. Depuis la suppression de l’ancien impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en 2018, seules les valeurs immobilières restent concernées, et la charge fiscale s’est allégée pour ceux dont la richesse se concentre en titres financiers.
Voici les principaux impôts auxquels sont confrontés les ultra-riches en France :
- Impôt sur le revenu : taux maximal de 45 %, mais rarement appliqué aux fortunes les plus importantes.
- Flat tax sur les revenus du capital : 30 %, sur dividendes et plus-values mobilières.
- IFI : concerne exclusivement l’immobilier, avec un taux progressif pouvant grimper à 1,5 %.
- Impôt sur les sociétés : s’applique aux entreprises, mais souvent atténué grâce à la structuration via holdings familiales.
Grâce à un jeu subtil de niches fiscales et à l’absence d’imposition sur les plus-values non réalisées, les plus fortunés parviennent à limiter significativement leur contribution, même quand la valeur de leur patrimoine s’envole. Le décalage entre l’évolution de la richesse et le montant réel d’impôts versé alimente sans relâche le débat sur la justice fiscale et la redistribution en France.
Propositions de loi récentes : vers une fiscalité plus équitable pour les grandes fortunes ?
La question d’une justice fiscale renforcée occupe désormais une place centrale dans le débat public. Depuis 2022, de nombreux textes parlementaires tentent de rééquilibrer la participation des plus fortunés au financement collectif. L’économiste Gabriel Zucman, fort des travaux de l’IPP, met en avant une réalité troublante : le taux d’imposition effectif des milliardaires reste parfois en dessous de celui des classes moyennes, ce qui alimente la réflexion sur un nouvel impôt « exceptionnel » à l’échelle des plus hauts revenus.
Les pistes de réforme prennent plusieurs directions, que voici :
- élargir l’assiette de l’impôt sur la fortune pour inclure les actifs financiers ;
- renforcer l’exit tax afin de limiter les départs à l’étranger pour raisons fiscales ;
- introduire une taxe sur les plus-values latentes, pour que la valorisation des actions non vendues ne reste plus hors champ de l’impôt.
Des propositions telles que la « contribution sur les ultra-riches » prônée par Michel Barnier ou la taxation accrue des « plus aisés » défendue dans certains cercles macronistes témoignent d’un terrain politique mouvant. Amélie de Montchalin, quant à elle, souligne la nécessité d’une coordination européenne pour éviter d’agir en solitaire dans un contexte de mobilité accrue des capitaux. La question demeure : comment adapter la fiscalité à ces nouveaux enjeux tout en préservant la transparence et l’adhésion de l’opinion ?
Inégalités fiscales : quelle part réelle des impôts pèsent sur les ultra-riches ?
Le système fiscal français laisse apparaître un contraste frappant. Les ultra-riches, détenteurs de richesses hors normes, voient leur taux d’imposition effectif diminuer à mesure que leur patrimoine gonfle. Les dernières études de l’IPP, signées Gabriel Zucman et Laurent Bach, révèlent que la contribution fiscale réelle des milliardaires reste proportionnellement inférieure à celle de la plupart des contribuables. La logique progressive de l’impôt, vantée dans les discours, s’inverse au sommet : plus hauts revenus et plus grandes fortunes bénéficient d’une palette d’optimisations, grâce à des dispositifs spécifiques et à l’arbitrage permanent de leur patrimoine.
La France, parfois qualifiée de « paradis fiscal pour les riches » par Oxfam, se retrouve en concurrence directe avec des juridictions plus accueillantes : Pays-Bas, Luxembourg, mais aussi États-Unis, Suède ou Nouvelle-Zélande. Les milliardaires français exploitent la différence de traitement entre la fiscalité du capital et celle du travail, allégeant leur impôt sur le revenu grâce à la flat tax, à la suppression de l’ISF ou à des stratégies patrimoniales sophistiquées. Les statistiques du ministère de l’Économie ne laissent guère de place au doute : la part d’impôts versée par les ultra-riches reste bien en deçà de ce que prévoit le barème théorique.
L’observatoire européen de la fiscalité indique que, parmi les économies développées, la France affiche un taux global d’imposition sur les plus hauts patrimoines inférieur à la moyenne. L’intensification de la circulation des capitaux, ajoutée à l’absence d’harmonisation européenne, accentue encore ce phénomène. Face à ce constat, les discussions parlementaires s’intensifient et la question de la place des grandes fortunes dans le financement collectif reste entière. Reste à savoir si le vent de la réforme soufflera assez fort pour bousculer l’ordre établi.