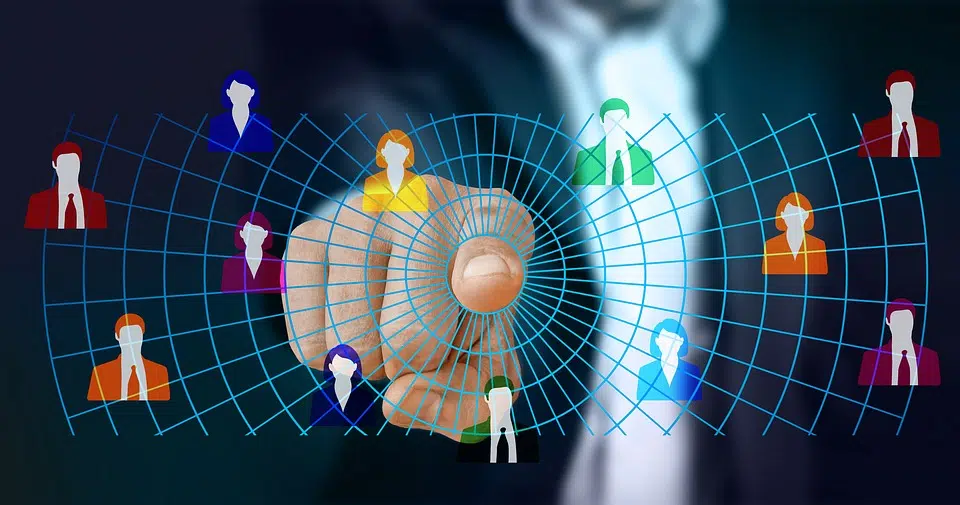À partir du 1er janvier 2025, le seuil de chiffre d’affaires permettant de bénéficier du régime micro s’élève à 80 000 euros pour les prestations de services, contre 77 700 euros auparavant. Cette modification s’accompagne d’une révision du mode de calcul des cotisations sociales, désormais basé sur un taux unique, quelle que soit l’activité exercée.
Certaines exonérations fiscales disparaissent, tandis que la distinction entre micro-entrepreneur et auto-entrepreneur devient officiellement obsolète. Ces évolutions réglementaires imposent une réévaluation des choix de statut et des modalités de gestion pour tous les indépendants concernés.
Le micro en 2025 : ce qui change pour les micro-entrepreneurs
2025 ne laisse pas le régime micro intact. La loi de finances relève les seuils de chiffre d’affaires à 80 000 euros pour les prestations de services, une adaptation qui colle à la réalité économique du moment. Les plafonds de la franchise en base de TVA suivent le mouvement : chaque micro-entrepreneur doit désormais garder un œil attentif sur ses recettes pour éviter toute mauvaise surprise.
Autre tournant : le calcul des cotisations sociales s’uniformise. Finies les variations de taux selon l’activité, tout le monde passe sous la même règle, ce qui clarifie la donne pour les indépendants. Plus besoin de jongler avec des exceptions sur le régime micro social : l’ensemble du dispositif s’affiche lisible, d’un seul bloc.
La création d’entreprise garde son aspect direct, mais l’inscription au RCS devient désormais systématique pour plusieurs professions, commerciales ou libérales. Quant à la CFE, l’exonération temporaire s’efface pour laisser place à un paiement dès la seconde année, sans possibilité de report. Le régime fiscal micro s’aligne sur ces évolutions : la séparation entre auto-entrepreneur et micro-entrepreneur appartient au passé.
Voici les transformations majeures à retenir :
- Seuils de chiffre d’affaires relevés, avec une révision régulière
- Cotisations sociales uniformisées avec un taux unique
- Régime fiscal micro : disparition des anciennes catégories
- Inscription au RCS généralisée pour de nombreuses activités
Créer une micro-entreprise reste rapide, mais les paramètres changent et imposent de la rigueur dès le départ. Ceux qui frôlent les nouveaux plafonds ou cumulent plusieurs sources de chiffre d’affaires devront anticiper : les prélèvements sociaux sont alignés, mais demandent d’être particulièrement attentif à ses comptes.
Quels avantages et limites face aux nouvelles règles ?
La micro-entreprise conserve son attrait pour lancer une activité, tester un projet ou cumuler des revenus sans se perdre dans la complexité du régime réel d’imposition. Sa force tient à une fiscalité allégée grâce à l’abattement forfaitaire appliqué en amont des cotisations sociales et de l’impôt. Que l’on relève du régime micro BIC ou du régime micro BNC, ce dispositif offre souvent une bouffée d’air lors des débuts. Autre point positif : l’accès facilité au microcrédit professionnel, une véritable porte d’entrée pour ceux que la banque traditionnelle ignore.
La protection sociale y gagne aussi en accessibilité : adhésion automatique à la sécurité sociale des indépendants, démarches simplifiées, absence d’obligation de bilan comptable. On règle ses cotisations sociales sur ce qui est réellement encaissé, limitant les mauvaises surprises de trésorerie. Et la franchise en base de TVA reste un levier de compétitivité, notamment pour les prestations à la personne où le client final ne paie pas de TVA supplémentaire.
Mais il y a un revers. La CFE, exigible dès la deuxième année, peut éroder les faibles marges. Impossibilité de déduire des charges réelles : ceux qui supportent beaucoup de frais professionnels ne pourront pas alléger leur imposition. Les plafonds, même réajustés, imposent une surveillance constante : dépasser la limite entraîne un transfert automatique vers le régime réel, alourdissant la gestion. Enfin, l’obligation d’assurance, responsabilité civile professionnelle ou assurance décennale selon le secteur, doit être intégrée dès le démarrage, sous peine de lourdes conséquences en cas d’incident.
Micro-entrepreneur et auto-entrepreneur : quelles différences subsistent ?
L’unification de 2016 a fusionné dans les textes les statuts de micro-entrepreneur et d’auto-entrepreneur. Pourtant, dans les conversations comme dans les couloirs administratifs, le terme « auto-entrepreneur » reste bien vivant. Mais derrière cette survivance du vocabulaire, la réalité a changé : aujourd’hui, la micro-entreprise constitue la seule référence légale.
Le micro-entrepreneur relève du régime micro, qui combine régime fiscal (abattement, franchise en base de TVA) et régime social simplifié. Ce n’est plus une catégorie à part, mais un type d’entreprise individuelle soumis à des plafonds de chiffre d’affaires. L’enregistrement se fait directement en ligne, avec rattachement automatique aux organismes de sécurité sociale.
Historiquement, l’auto-entrepreneur profitait d’une procédure encore plus allégée et d’une exonération de charges en première année, des facilités qui ont disparu. Pourtant, beaucoup continuent d’utiliser ce terme, par habitude, pour désigner la souplesse du régime micro : déclaration périodique, absence d’obligation de bilan, paiement des cotisations sociales sur l’encaissement effectif.
En 2025, la distinction ne subsiste qu’à l’oral. Légalement, toute création d’une entreprise individuelle sous le régime micro relève du statut de micro-entrepreneur. Le terme « auto-entrepreneur » appartient désormais au folklore administratif, sans incidence sur les droits ou obligations.
Comprendre les nouveaux régimes d’imposition et leur impact sur votre activité
Le virage de 2025 rebat les cartes pour le régime micro, avec des conséquences directes pour les micro-entrepreneurs et les activités de location meublée. Les plafonds de chiffre d’affaires sont réévalués, tout comme les abattements : 71 % pour les meublés de tourisme classés, 50 % pour les prestations de services en micro BIC. Ces changements obligent à examiner attentivement l’intérêt du régime réel d’imposition face à l’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu.
La franchise en base de TVA reste un repère solide : en-dessous de 36 800 € pour les services et 91 900 € pour la vente, la TVA ne s’applique pas, ce qui simplifie la facturation. Mais la généralisation de la facturation électronique (e-invoicing, e-reporting) change la donne. L’indépendant doit désormais se doter d’outils adaptés et se tenir prêt pour des contrôles renforcés.
Certains secteurs, comme la location meublée (y compris sous le régime LMNP), les services à la personne ou l’hébergement touristique, doivent composer avec des spécificités : la franchise de TVA peut s’avérer peu avantageuse, le choix entre micro BIC et amortissement doit être pesé pour préserver la trésorerie. Avant d’opter pour un régime, il devient indispensable d’analyser précisément sa situation : seuils, taux d’abattement, obligations de comptabilité simplifiée. La maîtrise des taux de cotisations sociales et des modalités de déclaration du chiffre d’affaires peut faire la différence entre équilibre et faux-pas.
Au final, le régime micro bouge, s’adapte, mais ne se laisse jamais dompter sans vigilance. Les indépendants qui sauront anticiper ces mutations tireront leur épingle du jeu, tandis que les autres risquent de subir le changement. 2025 sera sans doute l’année où le régime micro montrera qui sait naviguer dans la nouvelle donne.